
26 Mar 2024
A Rochefort les confessions sont Le samedi de 10h 45 à 11h 45 à l’église St Louis
Les chrétiens portent la vie nouvelle du Christ dans « des vases d’argile ». Soumise à la tentation, cette vie d’enfant de Dieu peut être affaiblie voire étouffée par le péché. C’est pourquoi le Christ, médecin des âmes confie à l’Église de perpétuer son œuvre de guérison et de salut auprès de ses membres. C’est le but du sacrement de pénitence qui est un sacrement de guérison.
Qu’est ce que le sacrement de réconciliation ou confession ? 
Le sacrement de la pénitence ou de la réconciliation est par excellence le sacrement de l’amour et de la consolation de Dieu. En tout premier lieu, se confesser, c’est confesser l’amour de Dieu et sa miséricorde. Et se rappeler la grâce du baptême qui nous a arraché au pouvoir du mal. Dans la suite de notre existence, le sacrement de pénitence est un peu un nouveau baptême. Après « l’eau du baptême », « les larmes de la pénitence »…
Origine du sacrement de réconciliation

l’enfant prodigue
Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation prend sa source dans le mystère pascal. En effet, le soir même de Pâques, l’évangile de Jean rapporte que le Seigneur apparaît aux disciples, enfermés au cénacle, et, après leur avoir adressé son salut « Paix à vous ! », souffle sur eux et dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis » (Jn 20, 21-23).
Jésus avait déjà averti qu’ « il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. » Et toute sa vie, il n’a eu de cesse d’offrir son pardon se montrant accueillant envers les pécheurs. En parabole, il se présentait comme le bon berger sorti à la recherche de son unique brebis perdue. C’est pour continuer cette œuvre de miséricorde que le Christ confie aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés dans un geste qui le rend présent et lui permet de relever les pécheurs.
Sens et signification
Pour la foi catholique, il existe un péché originel. Par son incarnation rédemptrice, (du latin redimere, « racheter c’est-à-dire payer la rançon d’un captif pour lui rendre la liberté »), le Christ en délivre l’humanité.
Mais un principe du mal reste à l’œuvre dans le monde. Le cœur de l’homme est parfois lourd et endurci, opaque à lui-même. La vie nouvelle reçue au baptême ne supprime pas la fragilité et la faiblesse de la nature humaine. L’inclination au péché demeure dans les baptisés. C’est l’occasion pour eux de faire leurs preuves dans le combat de la vie chrétienne avec le soutien de la grâce du Christ. En effet la confession régulière des péchés aide à former la conscience, à lutter contre les penchants mauvais, à se laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie avec l’Esprit-Saint. En recevant fréquemment, par ce sacrement, le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés à être miséricordieux comme lui.
Comment se confesser ?
On peut recevoir le sacrement de la réconciliation dans toutes les paroisses, dans les monastères et auprès de n’importe quel prêtre. Dans la plupart des églises, le sacrement de pénitence est administré dans des confessionnaux, ces guérites en bois qui jalonnent les bas-côtés ou ont été transformées en petites pièces confidentielles. On s’y présente après avoir préparé un examen de conscience à la lumière de la parole de Dieu. D’entrée de jeu, on peut demander au prêtre sa bénédiction. « Mon père, bénissez-moi car j’ai péché. » Dans les églises orientales, la coutume veut que le prêtre accueille le pénitent en lui posant l’étole sur la tête et un bras autour des épaules, par solidarité. Avant d’être pardonné de ses fautes, le pécheur fait acte de contrition, c’est-à-dire qu’il exprime son regret de les avoir commises. Il précise ensuite la nature de ses fautes en les confessant au prêtre qui lui donne l’absolution et une pénitence, c’est-à-dire une réparation ou satisfaction, le plus souvent quelques prières ou une parole de la Bible à méditer. Contrition, confession et réparation sont les actes nécessaires pour obtenir l’absolution. « Quand quelqu’un fait la queue pour se confesser, raconte le pape François, il ressent la honte, mais ensuite quand la confession se termine, il sort libre, grand, beau, pardonné, blanc, heureux. C’est ce qui est beau dans la confession ! » L’Église invite ses fidèles à recevoir ce sacrement une fois par an au moins. C’est l’origine de l’expression « faire ses Pâques » qui consiste à se confesser et à communier à la faveur de la fête de Pâque. Dans la vie spirituelle comme dans la vie quotidienne, on mange, on boit et on se lave. La communion eucharistique alimente l’âme, la confession la nettoie. L’une et l’autre doivent être fréquentes.
dans les monastères et auprès de n’importe quel prêtre. Dans la plupart des églises, le sacrement de pénitence est administré dans des confessionnaux, ces guérites en bois qui jalonnent les bas-côtés ou ont été transformées en petites pièces confidentielles. On s’y présente après avoir préparé un examen de conscience à la lumière de la parole de Dieu. D’entrée de jeu, on peut demander au prêtre sa bénédiction. « Mon père, bénissez-moi car j’ai péché. » Dans les églises orientales, la coutume veut que le prêtre accueille le pénitent en lui posant l’étole sur la tête et un bras autour des épaules, par solidarité. Avant d’être pardonné de ses fautes, le pécheur fait acte de contrition, c’est-à-dire qu’il exprime son regret de les avoir commises. Il précise ensuite la nature de ses fautes en les confessant au prêtre qui lui donne l’absolution et une pénitence, c’est-à-dire une réparation ou satisfaction, le plus souvent quelques prières ou une parole de la Bible à méditer. Contrition, confession et réparation sont les actes nécessaires pour obtenir l’absolution. « Quand quelqu’un fait la queue pour se confesser, raconte le pape François, il ressent la honte, mais ensuite quand la confession se termine, il sort libre, grand, beau, pardonné, blanc, heureux. C’est ce qui est beau dans la confession ! » L’Église invite ses fidèles à recevoir ce sacrement une fois par an au moins. C’est l’origine de l’expression « faire ses Pâques » qui consiste à se confesser et à communier à la faveur de la fête de Pâque. Dans la vie spirituelle comme dans la vie quotidienne, on mange, on boit et on se lave. La communion eucharistique alimente l’âme, la confession la nettoie. L’une et l’autre doivent être fréquentes.
Pourquoi demander le sacrement de réconciliation ?
Parce que c’est une rencontre vivante avec la miséricorde, même si l’aveu est une démarche exigeante. « On peut ressentir de la honte. C’est une bonne chose, assure encore le pape François. Il est bon d’avoir un peu honte, car avoir honte est salutaire. La honte rend plus humbles, et le prêtre reçoit avec amour et avec tendresse cette confession et, au nom de Dieu, il pardonne. » Alors on peut être résolu à reconstruire avec Dieu ce qu’on détruisait par le péché. C’est la pénitence envers soi-même, les personnes que l’on lésait, l’Église ou le monde. Dieu lui même prend alors en charge ce qui parait humainement irréparable. Le pardon est un cadeau.
Bonus
« Chers amis, célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enveloppés par une étreinte chaleureuse : c’est l’étreinte de la miséricorde infinie du Père. Rappelons cette belle parabole du fils qui est parti de chez lui avec l’argent de son héritage ; il a gaspillé tout son argent et ensuite, quand il n’avait plus rien, il a décidé de revenir chez lui, non comme un fils, mais comme un serviteur. Il ressentait profondément sa faute dans son cœur et tant de honte. La surprise a été que quand il commença à parler, à demander pardon, son père ne le laissa pas parler, il l’embrassa et fit la fête. Quant à moi je vous dis: chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous embrasse, Dieu fait la fête ! Allons de l’avant sur cette route. »
Pape François, audience générale, mercredi 19 février 2014
Magali Michel

25 Mar 2024
Le Jeudi Saint célèbre le dernier repas du Christ avec ses douze apôtres.
Au cours de ce repas, la Cène, Jésus lave les pieds de ses disciples et il les désigne prêtres de la Nouvelle Alliance. Il prend le pain et le vin, il rend grâce, instituant ainsi le Sacrement de l’Eucharistie. Il annonce que l’heure de l’épreuve approche. Après le repas, le Christ et les apôtres se rendent au jardin des Oliviers pour veiller et prier.
Alors que ses disciples s’endorment harassés de fatigue et d’angoisse, le Christ est tenté par le Malin, dont il rejette les tentations pour accepter la coupe que lui destine Dieu son Père. C’est là que Judas arrive avec les soldats du Temple pour l’enlever.
QUEL ÉTAIT LE SENS DU REPAS PASCAL AU TEMPS DE JÉSUS ?
Le repas pascal, au temps de Jésus, avait lieu le soir du 14 nissan qui correspond au Jeudi saint. Ce repas appelé Seder commémorait la libération des Hébreux de l’esclavage qu’ils subissaient en Égypte et plus précisément le repas, appelé pascal, que mangèrent les Hébreux debout, à la hâte, avant de quitter l’Égypte et de partir vers le désert.
Dans le chapitre 12 du livre de l’Exode il est demandé au peuple juif de faire mémoire de ce jour extraordinaire : le jour où Dieu a sauvé son peuple de l’esclavage (Ex 12/14).
Le repas du Seder se prend dans les deux premiers jours de la Pâque (Pessah) qui dure sept jours (la semaine des Azymes) et qui célèbre a la fois la fertilité de la terre et la sortie d’Égypte.
Pendant la semaine des Azymes (hag ha-matsot) on ne prend aucune nourriture contenant du levain ; on mange donc du pain azyme.
Ainsi dans l’histoire du salut, Jésus célèbre simultanément la dernière Pâque juive et la première Pâque chrétienne. Il ne s’agit plus de se préparer à la traversée de la Mer Rouge, mais bien à la traversée de la mort, par sa Passion et sa Résurrection.
De même que le peuple juif fait mémoire de l’Exode, de même, le Christ demande aux apôtres : « Faites cela en mémoire de moi ». C’est pourquoi nous, chrétiens, célébrons cette Pâques tous les dimanches lors de l’Eucharistie, à la messe
LES RITES DU JEUDI SAINT
C’est avec la messe du soir du Jeudi saint que commence le Triduum pascal, ce temps de trois jours qui englobe les fêtes de Pâques.
Et puisque tout commence le Jeudi saint, le tabernacle est forcément vide avant le début de la messe. Pour célébrer cette grande fête, les célébrants revêtent des vêtements blancs, les cloches sonnent une dernière fois lors du Gloria avant de se taire jusqu’au dimanche de Pâques pour commémorer la mort du Christ.
De nombreuses paroisses reprennent le rite du lavement des pieds symbolisant le service et la charité du Christ qui « n’est pas venu pour être servi mais pour servir » (Mt 20, 28) tandis que les fidèles chantent des hymnes à la charité.
Dans de nombreuses églises, une veillée d’adoration et de prières suit la messe du Jeudi Saint afin de méditer en silence sur l’agonie de Jésus dans la solitude du jardin des oliviers à Gethsémani, pour répondre à son appel « Venez et priez ».

24 Mar 2024
Horaires des messes des Rameaux sur les paroisses de Rochefort et Tonnay-Charente :
- Dimanche 24 mars : – à 9h30 à l’église St Pierre du Breuil Magné – à 10h30 à l’église St Etienne de Tonnay-Charente. – à 11h00 à l’église St Louis.
– 18h00 Exceptionnellement pas de messe
Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem.
La foule l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur.
C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux (de buis, d’olivier, de laurier ou de palmier), selon les régions. Ces rameaux, une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ.
d’olivier, de laurier ou de palmier), selon les régions. Ces rameaux, une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ.
La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Ces paroles sont chantées comme antienne d’ouverture au lieu où les fidèles se sont réunis : après une brève allocution, le célébrant bénit les rameaux et on lit le récit évangélique de l’entrée messianique de Jésus avant de se rendre en procession jusqu’à l’église.
La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, les rameaux bénits, pour en orner les croix dans les maisons : geste de vénération et de confiance envers le Crucifié.

19 Mar 2024
Samedi 23 mars 2024 de 14h30 à 17h00 dans les salles paroissiales 65 bis rue Voltaire.
Viens nous rejoindre avec tes amis pour un après midi de partage, découverte, jeux autour de la célébration des Rameaux.

29 Fév 2024
Le Temps du Carême s’étend de Matines du Mercredi des Cendres jusqu’à la Messe de la Vigile Pascale exclusivement.
Cheminons avec nos frères du Canada
les fiches pour suivre le Carême sur notre diocèse de la Rochelle et Saintes

Retrouvez ici, semaine après semaine, les fiches de carême préparées par le Service de la Vie spirituelle.
Quelle est l’origine du Carême ?
Le Carême vient d’une prise de conscience progressive de l’importance de la Fête de Pâques et de la nécessité de bien s’y préparer.
Au début du IVe siècle, cette période préparatoire comportait à Rome trois semaines, puis on adopta les quarante jours symboliques (d’où l’appellation de « Carême », du latin « Quadragesima »). Plus tard, au VIe siècle, furent ajoutés quatre jours supplémentaires pour obtenir les quarante jours de jeûne, après soustraction des Dimanches, où l’on ne jeûne jamais.
Quelle est la signification du nombre quarante ?
Quarante est un nombre sacré exprimant dans la Bible la préparation et la purification :
• Témoins les quarante jours du Déluge, les quarante années que le Peuple de Dieu passa dans le désert, les quarante jours de prière et de jeûne de Moïse au mont Sinaï et du Prophète Élie en marche vers l’Horeb ;
• Témoin surtout la Retraite de Jésus au désert.
C’est en suivant le Christ au désert et en s’unissant à son Jeûne que les Chrétiens se préparent à entrer avec Lui dans le Mystère de la Croix, pour participer à la Gloire de sa Résurrection.
A quoi nous prépare le Carême ?
Le Temps du Carême est une triple préparation :
• Préparation de tous les fidèles à Pâques.
• Préparation des catéchumènes au Baptême. À plusieurs reprises au cours du Carême, des assemblées regroupant tout le peuple – appelées « scrutins » – étaient organisées. Les catéchumènes y recevaient une instruction et participaient à des cérémonies destinées à les initier progressivement aux Mystères Chrétiens. On retrouve des traces de ces étapes dans certaines Messes, comme aussi dans les Cérémonies du Baptême.
• Préparation des pénitents publics à leur réconciliation. Ayant été excommuniés pour des fautes graves et publiques, ces pénitents venaient solliciter leur réconciliation avec l’Église : ils recevaient les Cendres au début du Carême et étaient absous le Jeudi Saint.
Cette discipline de la pénitence publique cessa vers le XIe siècle, et la Cérémonie des Cendres s’élargit alors à tous les fidèles.
Quels sont les deux principaux thèmes du Carême ?
L’annonce de la Passion, de la Mort et de la Résurrection du Christ, afin de nous préparer à revivre et renouveler en nous le Mystère central de notre foi.
La lutte contre le démon et le péché. Satan ne cesse de nous détourner de Dieu et de nos devoirs, et d’exciter nos passions, nos désirs d’indépendance et de richesses.
A quelles bonnes œuvres sommes-nous surtout conviés pendant le Carême ?
Nous sommes surtout conviés :
• Par rapport à Dieu, à la prière : prendre du temps pour Dieu, en silence, nous laisser remplir de Lui et nourrir notre âme de sa Parole. Venir à la Messe en semaine si cela nous est possible.
• Par rapport à nous-mêmes, au jeûne : retranchement dans la nourriture et la boisson, dans le tabac, les curiosités, la télévision ou l’ordinateur, etc., pour nous unir aux Souffrances du Christ, expier nos péchés et nous corriger de nos mauvaises habitudes.
• Par rapport aux autres, à l’aumône ou à l’exercice de la charité : donner de son temps (en disponibilité aux autres, visite de malades, service des plus pauvres) ; donner de ses biens (partage, dons).
Que nous demande l’Église au sujet du jeûne et l’abstinence ?
L’Église nous rappelle que « tous les fidèles sont tenus par la Loi divine de faire pénitence chacun à sa façon » (Code de droit canonique).
Le jeûne consiste à ne prendre qu’un seul repas complet et deux Collations (une soupe et un morceau de pain par exemple). On y est tenu le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint, entre 18 et 60 ans, sauf raison particulière.
L’abstinence est la privation de viande. En France, elle n’est obligatoire que les Vendredis de Carême. Elle peut être remplacée les autres Vendredis par un autre acte de pénitence. Elle oblige à partir de 14 ans.
Jusqu’à un temps assez récent, les Catholiques jeûnaient et faisaient abstinence tous les jours du Carême. Chacun reste aujourd’hui invité à faire plus que le peu prescrit.
Quelles sont les particularités liturgiques de ce Temps ?
Chaque jour du Carême comporte une Messe propre, avec ce qu’on appelle une « station » particulière, c’est-à-dire une réunion de la communauté chrétienne de Rome dans une église déterminée, pour y prier et célébrer en commun l’Eucharistie. Les Messes en semaine comportent aussi une « Oraison sur le Peuple », qui servait autrefois de Bénédiction finale.
Par ces Messes propres à chaque jour, l’Église invite les fidèles à participer plus fréquemment au Saint Sacrifice. Les ornements sont violets, l’orgue se tait et on ne met pas de fleurs sur les Autels.
Quelles Grâces particulières pouvons-nous demander ?
Le regret de nos péchés, le ferme propos d’en faire pénitence et de nous en corriger. « Le temps du jeûne nous ouvre les portes du Paradis : recevons-le en priant et en suppliant, afin qu’au Jour de la Résurrection nous nous réjouissions avec le Seigneur » (Répons de Matines)
Donnons-nous surtout à Jésus, et demandons-Lui qu’Il établisse en nous, en nos proches et en toute l’Église son Esprit de pénitence, de prière et de sacrifice.

1 Fév 2024
L’Église célèbre, le 2 février, la Présentation du Seigneur au Temple, qui clôture les solennités de l’Incarnation. Cette fête est aussi la Journée de la vie consacrée.
 Ce vendredi 2 février messe à 18h15 à la chapelle de Notre Dame de Lourdes de l’église St Louis. Ce sera l’occasion de rendre grâce pour la présence des religieuses sur notre paroisse.
Ce vendredi 2 février messe à 18h15 à la chapelle de Notre Dame de Lourdes de l’église St Louis. Ce sera l’occasion de rendre grâce pour la présence des religieuses sur notre paroisse.
La fête de la Présentation de Jésus au Temple, aussi appelée fête de la purification, est plus connue sous le nom populaire de Chandeleur.
Ce nom, qui signifie “fête des chandelles”, a pour origine la procession par laquelle débute la célébration. Par ce geste, nous nous souvenons que c’est par le titre « Lumière pour éclairer les nations païennes » (Luc 2, 32), que Syméon accueille Jésus lors de la Présentation au Temple par Marie et Joseph, quarante jours après sa naissance.
Par ailleurs, la présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix.
rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix.
Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le Salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, nous vous adressons cette humble prière : puisque votre Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le Temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter un jour devant vous. Amen.
En 1997, le pape Jean-Paul II fait du 2 février la journée de la vie consacrée, journée placée sous le signe de l’action de grâce et de la découverte de cette vie consacrée :
Il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères.
En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre.
[Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées ] à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la vie du monde
Jean-Paul II
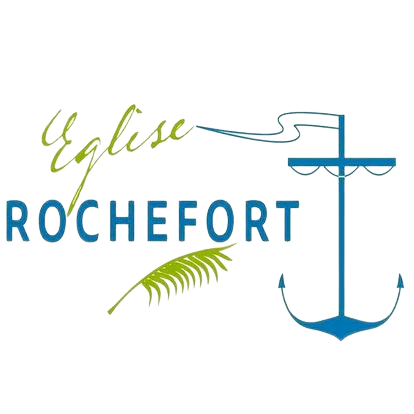



 dans les monastères et auprès de n’importe quel prêtre. Dans la plupart des églises, le sacrement de pénitence est administré dans des confessionnaux, ces guérites en bois qui jalonnent les bas-côtés ou ont été transformées en petites pièces confidentielles. On s’y présente après avoir préparé un examen de conscience à la lumière de la parole de Dieu. D’entrée de jeu, on peut demander au prêtre sa bénédiction. « Mon père, bénissez-moi car j’ai péché. » Dans les églises orientales, la coutume veut que le prêtre accueille le pénitent en lui posant l’étole sur la tête et un bras autour des épaules, par solidarité. Avant d’être pardonné de ses fautes, le pécheur fait acte de contrition, c’est-à-dire qu’il exprime son regret de les avoir commises. Il précise ensuite la nature de ses fautes en les confessant au prêtre qui lui donne l’absolution et une pénitence, c’est-à-dire une réparation ou satisfaction, le plus souvent quelques prières ou une parole de la Bible à méditer. Contrition, confession et réparation sont les actes nécessaires pour obtenir l’absolution. « Quand quelqu’un fait la queue pour se confesser, raconte le pape François, il ressent la honte, mais ensuite quand la confession se termine, il sort libre, grand, beau, pardonné, blanc, heureux. C’est ce qui est beau dans la confession ! » L’Église invite ses fidèles à recevoir ce sacrement une fois par an au moins. C’est l’origine de l’expression « faire ses Pâques » qui consiste à se confesser et à communier à la faveur de la fête de Pâque. Dans la vie spirituelle comme dans la vie quotidienne, on mange, on boit et on se lave. La communion eucharistique alimente l’âme, la confession la nettoie. L’une et l’autre doivent être fréquentes.
dans les monastères et auprès de n’importe quel prêtre. Dans la plupart des églises, le sacrement de pénitence est administré dans des confessionnaux, ces guérites en bois qui jalonnent les bas-côtés ou ont été transformées en petites pièces confidentielles. On s’y présente après avoir préparé un examen de conscience à la lumière de la parole de Dieu. D’entrée de jeu, on peut demander au prêtre sa bénédiction. « Mon père, bénissez-moi car j’ai péché. » Dans les églises orientales, la coutume veut que le prêtre accueille le pénitent en lui posant l’étole sur la tête et un bras autour des épaules, par solidarité. Avant d’être pardonné de ses fautes, le pécheur fait acte de contrition, c’est-à-dire qu’il exprime son regret de les avoir commises. Il précise ensuite la nature de ses fautes en les confessant au prêtre qui lui donne l’absolution et une pénitence, c’est-à-dire une réparation ou satisfaction, le plus souvent quelques prières ou une parole de la Bible à méditer. Contrition, confession et réparation sont les actes nécessaires pour obtenir l’absolution. « Quand quelqu’un fait la queue pour se confesser, raconte le pape François, il ressent la honte, mais ensuite quand la confession se termine, il sort libre, grand, beau, pardonné, blanc, heureux. C’est ce qui est beau dans la confession ! » L’Église invite ses fidèles à recevoir ce sacrement une fois par an au moins. C’est l’origine de l’expression « faire ses Pâques » qui consiste à se confesser et à communier à la faveur de la fête de Pâque. Dans la vie spirituelle comme dans la vie quotidienne, on mange, on boit et on se lave. La communion eucharistique alimente l’âme, la confession la nettoie. L’une et l’autre doivent être fréquentes.

 d’olivier, de laurier ou de palmier), selon les régions. Ces
d’olivier, de laurier ou de palmier), selon les régions. Ces 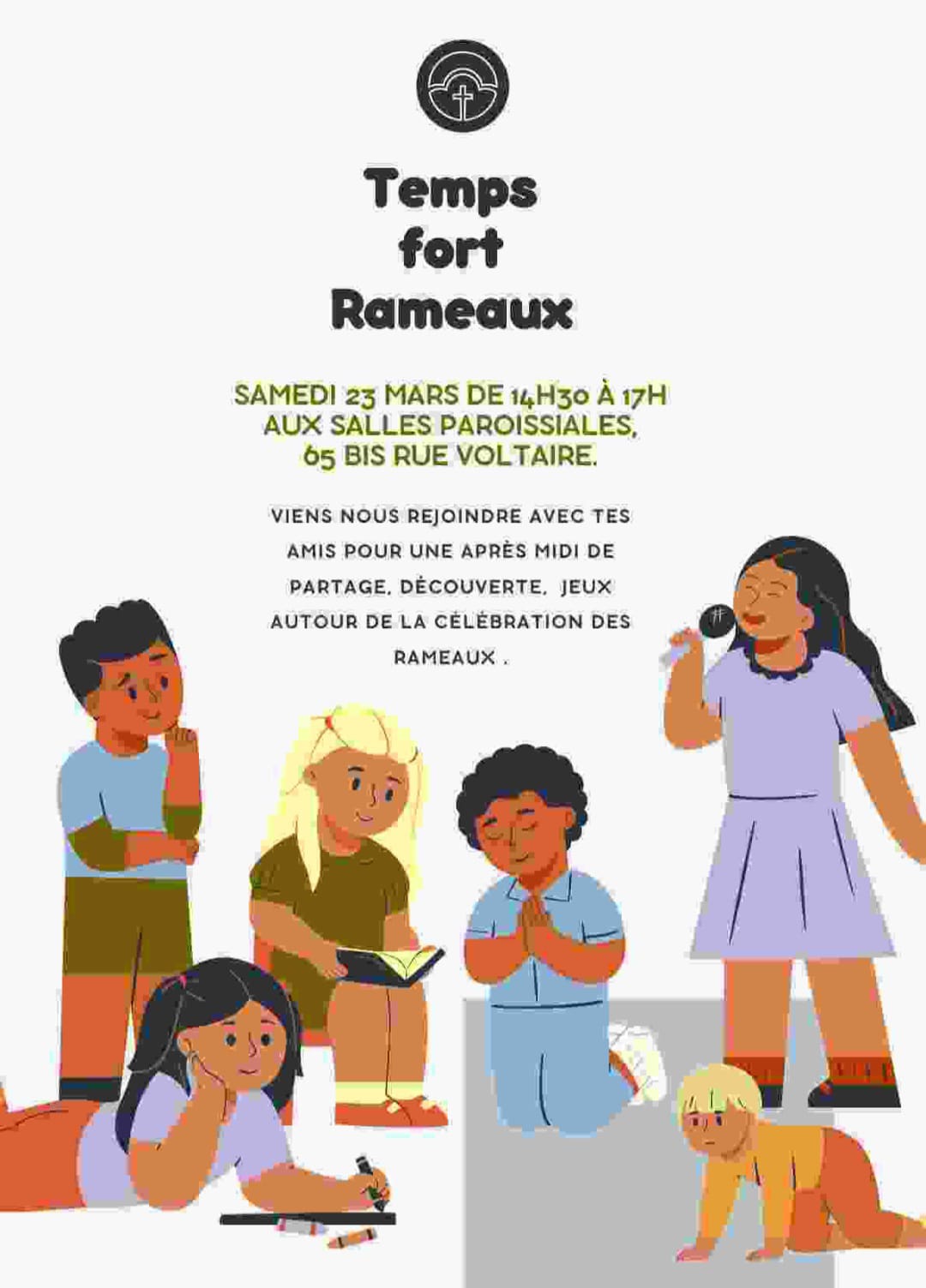




 rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix.
rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix.